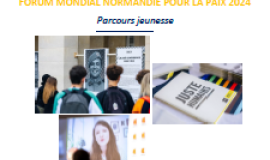Ce texte est issu d’une série de séjours ethnographiques de plusieurs mois au sein de brigades de combattants en Syrie (2012, 2014) puis en Irak (2017). Ces recherches sont en cours et visent essentiellement à approcher la quotidienneté des combattants pour comprendre leurs trajectoires biographiques, leurs rapports ordinaires au monde, à autrui et à eux-mêmes. Au final, ces recherches tentent de cerner les médiations sociales, historiques et contextuelles qui organisent l’expérience de la guerre. Elles espèrent aboutir à une théorie de la réflexivité et de la subjectivité en temps de guerre, c’est-à-dire à appréhender les rationalités générales des actions, des objectifs, des conduites et des formes de vie des combattants. Ce texte vise moins à restituer les résultats de cette enquête qu’à formuler une nouvelle hypothèse relative à la dimension sensible de la guerre.
Les explications sociologiques et politiques relatives au basculement des combattants étrangers dans le djihad armé suivent en principe deux perspectives différentes. La première cherche à dégager les facteurs du contexte social qui expliquent le basculement de certains dans des parcours de radicalisation djihadistes (inégalités sociales, exclusions, discriminations, expériences de l’injustice, etc.). La deuxième perspective, quant à elle, vise à analyser les processus et la dynamique des violences, en s’appuyant sur un profilage sociologique des parcours des candidats au djihad. La plupart des études s’accordent sur un diagnostic qui favorise l’expérience guerrière (frustration et crise sociales). En bref, il existe des configurations sociales spécifiques qui créent des conditions favorables à la violence.
Ces explications sont évidemment importantes et nécessaires. Néanmoins, le but de ce texte se tient en décalage par rapport à ces explications sociologiques traditionnelles. Il s’agit de questionner les ressorts subjectifs susceptibles d’animer de jeunes Occidentaux à rejoindre l’État islamique pour combattre sur les fronts syriens et irakiens. Parmi ces ressorts, l’un est intrinsèque à la guerre en tant « qu’expérience sensible ». L’hypothèse, qui ne se suffit pas à elle-même et qui ne saurait répondre à la globalité de la question, est que la guerre est l’occasion d’une expérience sensible du monde qui, non seulement attire les êtres en attente de « réparation existentielle », mais qui les maintient également dans la lutte armée en raison notamment des éclats existentiels qu’elle suscite.
Cet article s’attache donc à la dimension sensible de la guerre en tant qu’elle fascine et attire. D’ailleurs, rares sont ceux qui peuvent se soustraire à cette curiosité remplie de peur, car on ne saurait concevoir spectacle plus inquiétant que celui de jeunes hommes, déterminés, bien vivants et lucides, à jeter leur vie au nom, par exemple, de l’État islamique et à subir l’emprise impitoyable d’une passion insensée.
La guerre comme « expérience existentielle »
Le célèbre écrivain allemand E. Jünger a largement insisté sur cette dimension. Pour lui, la guerre est une expérience existentielle et philosophique. Elle réveille et sort l’individu des platitudes existentielles auxquelles il s’était auparavant accommodé. Engagé dans la guerre, l’homme est agité par une idée qui le saisit tout entier au point qu’il en vient à considérer que les « devenirs » sont supérieurs à la vie. En s’exposant quotidiennement à la perte, la subjectivité du combattant prend une forme tout aussi étrange que menaçante ; il devient insensible à sa propre mort comme à celle de son ennemi.
Cette question du processus qui conduit à ôter des vies et à s’offrir ainsi à la mort est tout à fait déroutante. Elle a constitué un sujet de prédilection pour la philosophie, la sociologie ou encore la psychologie. Au fond, l’énigme demeure et peut se formuler de la manière suivante : comment un homme ordinaire parvient-il à vaincre sa répugnance au crime et comment accepte-t-il de tuer et de mourir pour des motifs qui ne lui sont pas strictement individuels ? Comment une tolérance à l’horreur est-elle susceptible de se développer de telle sorte que la mort devienne sinistrement un mode de vie ? Comment les hommes sont–ils capables de se familiariser avec le mal radical ? (Arendt, 2001 ; Revault d’Allonnes, 1995).Les combattants de l’État islamique, habitués aux pratiques de l’attentat suicide, révèlent particulièrement cette idée. Comme le rappelait Judith Butler (2016), le combattant meurt avec ses victimes dans une « intimité thanatopolitique absolue ». L’acte est simultanément autodétermination et auto-annihilation. Pour Judith Butler d’ailleurs, l’attentat suicide est un acte relationnel, voire même le « paradigme de l’exposition absolue à l’Autre ». Il tue avec son propre corps et sa mort va avec celle de l’autre. C’est une « mort qui fusionne avec celle de son ennemi », précise l’auteure. Cette exposition est tellement excessive qu’elle en devient insensible à la sensibilité de cet Autre. Le geste est absolu. Il n’administre pas seulement la mort. Il réduit en miettes son propre corps et celui qu’il fictionnalise comme son ennemi (Mbembe, 2006).
Le recours à des mythes pour justifier la mort
Une première hypothèse consiste à supposer que l’adhésion de la raison à une idéologie rende possible l’horreur. Les combattants ont recours à des mythes pour rendre acceptable, voire désirable, l’épouvante. Au sujet de l’État islamique par exemple, il est convenu de penser que leurs outils de propagande et leurs visions de la religion constituent les principales médiations qui rendent possible la formation d’une telle subjectivité combattante.
L’attachement absolu au mythe religieux constituerait non seulement un facteur d’engagement mais, plus encore, une manière d’annihiler l’horreur que le réel de la guerre inspire. La religion aiderait alors se détacher du monde et à opérer une requalification de celui-ci. Pour ces analystes acquis à cette explication, la religion aurait surtout constitué une ressource de sens alors que le monde apparaît comme absurde voire comme totalement injustifié dans sa forme actuelle. Non seulement la médiation religieuse rendrait intelligible ce qui est absurde, injuste et dépourvu de sens, mais irait également plus loin. Elle permettrait ainsi de domestiquer l’inquiétant et l’indéterminé. En Syrie par exemple, on constate que le registre religieux s’était accru à mesure que la forme de pensée révolutionnaire s’épuisait. Au fond, la religion a surgi lorsque la révolution a été défaite (Huët, 2015).
Cette explication est insuffisante. On peut même supposer qu’il n’y a aucune raison de croire que les candidats au djihad sont nécessairement des êtres atomisés, manipulables et totalement sous l’emprise de l’idéologie religieuse. Évidemment, la raison religieuse – quelle qu’elle soit – joue un rôle important. Seulement, le rapport au religieux des djihadistes n’est pas nécessairement fusionnel.
Il est même tout à fait probable que le djihadiste vive son expérience religieuse avec quelques distances. Depuis les études d’Émile Durkheim (1912), on sait que l’homme religieux n’adore pas vraiment ses dieux, ses esprits ou ses forces surnaturelles. Il adore plutôt sa société, la force de sa communauté. Selon cette perspective, rejoindre l’État islamique revient à s’approcher d’une totalité sociale, d’une force commune, d’un corps politique extrêmement cohésif qui serait alors une source d’exaltation et de fascination collective.
L’EI, en tant qu’organisation coupée du monde au sens où elle est « seule contre tous », offre une compensation narcissique à l’être faible et sans force. En effet, avant son engagement dans la guerre, l’être était probablement emmuré dans toute une série d’impuissances, d’humiliations subies, et de petites contingences qui s’accumulaient et étaient susceptibles de produire de profonds désajustements entre lui et le monde. Devant le constat de sa propre faiblesse structurelle et de sa difficulté à s’approprier le monde, il serait alors enclin de rechercher des compensations narcissiques dans une organisation collective toute puissante.
Le djihad comme compensation narcissique
T.W Adorno (1966) utilisait le concept de « narcissisme collectif » pour expliquer l’avènement des systèmes totalitaires. Ceci désigne un mécanisme général d’identification rigide à un groupe social restreint, c’est-à-dire une tendance à se cramponner à un système de convictions étroites afin de restaurer l’individu en proie à l’expérience de l’impuissance. Pour lui, l’individu se soumet à des puissances collectives, à des personnes autoritaires, à des mondes extrêmement normés au point que toute l’existence fait l’objet d’une codification précise, parce qu’il sent déjà le gouffre sous ses pieds et parce qu’il ne parvient pas à se réaliser lui-même ou à tracer pour lui-même les voies de son autonomie. Il se laisse alors aisément vaincre et porter par un mouvement totalitaire.
Ainsi, cette première hypothèse suggère en creux que l’engagement djihadiste trouve ses raisons dans l’évidemment du réel. L’évidemment du réel désigne un monde qui n’offre aucune prise concrète à l’existence. À mesure que l’individu est dessaisi de sa capacité à intervenir sur le cours des choses, ce dernier serait tenté de rechercher des espaces qui, non seulement offrent des réserves de sens, mais surtout, des mondes qui ouvrent à l’action. Au fond, l’EI offre un monde praticable.Selon cette idée, le candidat à la guerre est la figure d’un être qui ne s’est pas encore conquis. D’une certaine manière, l’existence radicalement inaccomplie conduit à adhérer à des fétiches, à une quête de certitudes et à des délires. En rejoignant l’EI, l’individu est alors relevé de sa position d’humilié. La compensation narcissique réside précisément dans ce fantasme de l’expressivité du sujet puissant, en pleine possession de lui-même, agissant sur le cours de l’histoire, tout en étant soutenu par une totalité sociale. La vie apparaît alors sous un nouveau jour : il existerait une vie où les actes ont un sens, une vérité à laquelle se rattacher, un retournement possible contre l’oppresseur. Le djihadiste incarne alors la figure narcissique du sujet puissant qui s’auto-rassure et qui agit pour l’avènement d’un monde voulu par la transcendance et qui fait rupture dans le cours de l’histoire.
Une des forces tout à fait surprenantes de l’EI est probablement d’avoir réussi à former l’image d’un monde resserré où l’unité est d’une puissance telle qu’elle annule toutes les questions encore ouvertes sur l’existence. Au sein des brigades, les combattants vivent en totale promiscuité. Les solidarités se radicalisent en particulier pour que chacun puisse prendre l’habitude de se dépasser pour affronter le combat. Elles protègent aussi des atteintes de la réalité. La guerre est indéniablement une expérience de la communauté.
Mais surtout, et c’est le point sur lequel je voudrais insister, l’EI rend le monde appropriable ; en son sein, la vie se trouve un but précis. On y occupe une place, on ajoute une part à ce monde, et on endosse des responsabilités précises. Qu’un individu s’occupe d’une tâche mineure (contrôle dans les check-points, surveillance de prison, entretien domestique nécessaire à la vie commune, etc.), ou majeure (combat, activité de renseignement), il a cette conviction de poser des actes censés dans le réel. L’ensemble des actes quotidien a sens eu égard au combat existentiel et politique mené par l’État islamique.
Ceci procure ce sentiment neuf et inattendu de la nécessité même de son existence et remplit les veines d’un sang chaud. En bref, le combattant se sent exister et destiné à un avenir. C’est cette « capacité retrouvée » qui pourrait expliquer l’aisance avec laquelle le combattant s’accommode de sa nouvelle vie, d’un monde dévasté de la guerre, et des ruines au sein duquel il agence son quotidien.
La guerre engendre une situation de dépossession du rapport ordinaire au monde
La seconde hypothèse est que la guerre est une expérience existentielle particulière. En effet, la guerre a ceci de spécifique, qu’elle rappelle avec force la fragilité des formes sociales et de la vie. Le réel se trouve fragilisé et la vie incessamment menacée. En d’autres termes, la guerre engendre une situation quasi-permanente de dépossession du rapport ordinaire au monde. Le monde perd de toute sa valeur propre pour devenir un lieu incertain et soumis aux aléas des destructions humaines. Les hommes expérimentent ainsi l’effondrement concret du monde – ce qui est susceptible de les confirmer dans leur attachement à la guerre.
Cet effondrement est d’abord matériel. Dans les zones de front, les paysages sont poussiéreux, les murs éventrés, les rues dévastées. Les bâtiments se montrent précaires et incertains. Pourtant, habituellement dans les temps de paix, leur solidité et leur capacité à durer garantissent la stabilité de ce monde. L’espace anthropologique est un espace existentiel agencé par des monuments, par des bureaux administratifs, par des habitations, etc. Or, tous ces repères matériels sont susceptibles de s’écrouler à chaque instant comme ce fut le cas lors de l’explosion récente de la mosquée à Mossoul.
Dans la guerre, se dressent plutôt les ruines. Ces dernières objectivent la fin d’un monde ou, tout du moins, le déréalisent. Le monde apparaît physiquement confus. De toute évidence, les ruines exposent le sujet à une expérience bouleversante ; celle d’un dessaisissement de soi et d’un étouffant sentiment d’irréalité. Pour le dire autrement, elles sont l’expérience sidérante d’une réalité qui s’effondre.
Pour le nouvel arrivant dans les terres du djihad, ce paysage instable pourrait donner raison à ses croyances en la fin d’un monde et en l’avènement douloureux d’un nouveau. Privé de l’assurance d’un monde, le combattant s’expose à une plus grande désorientation et pourrait alors s’attacher plus fermement aux quelques vérités de son nouveau groupe d’appartenance. En effet, comment peut-il affronter seul cette part nocturne de l’existence ? Comment peut-il se familiariser dans la solitude à ce réel effondré ?
Cette rupture de son rapport ordinaire au monde se vit aussi du point de vue de sa construction biographique. E. Jünger expliquait que la guerre fait advenir un nouveau « je ». Les propagandistes l’ont bien compris, puisqu’ils s’efforcent de mythifier la figure du combattant. Cette figure se doit être désirable et s’offrir à l’imitation. Le combattant est alors présenté comme un être doté de vertus exceptionnelles. En quelque sorte, il a vaincu l’humaine condition ; l’attachement démesuré à la vie médiocre, la peur de la blessure et de la mort, etc. Désormais il éprouve sa vie comme authentique car il exprime un rapport passionné à ses idées au point que son existence entière est consacrée à l’avènement de celles-ci. Les propagandistes ont pris pour habitude d’élever le courage du combattant qui éprouve l’idée dans son corps au point de l’offrir toujours au péril.
La figure du combattant est séduisante car elle incarne cette possibilité qu’à l’homme de se dépasser lui-même au nom d’une idée. Dans le même mouvement, par contraste, il porte aussi au jour l’inconsistance ontologique, le manque à être, le peu d’essence, et les faibles convictions de l’être qui n’éprouve pas l’idée dans son corps.
Etre transporté dans un « ailleurs » au cours d’une jouissance individuelle et collective
Cette rupture du rapport ordinaire à la vie n’est pas seulement un fantasme médiatique organisé par les communicants de l’EI. Concrètement, l’entrée dans la guerre est littéralement l’entrée dans un monde. Cela revient à la possibilité de traverser un univers, d’être transporté ailleurs au cours d’une jouissance individuelle et collective.
La jouissance est d’abord vécue en amont du voyage car les obstacles à l’accomplissement du djihad sont nombreux et ceux-ci ne sont pas seulement moraux. Il faut pouvoir mener une vie clandestine en attendant le départ. Le candidat au djihad est tenu de dissimuler ses projets, de rejoindre secrètement les réseaux djihadistes, de préparer concrètement son voyage. Bref, pour le candidat au djihad, la clandestinité devient un mode de vie. Les formes du secret et de la clandestinité offrent cette garantie de l’importance de l’affaire entreprise. Il ressent cette puissance ésotérique de se rendre invisible, de se dissimuler, de se rendre incommunicable afin de se défaire, dans la solitude, de la puissance de la société et de ses interdits.
Pour le nouveau djihadiste, l’entrée concrète dans la guerre est ensuite le temps d’une rupture avec la vie d’avant : une vie inaccomplie et incomprise, manquée dans ses finalités essentielles et toujours restée en dehors d’elle-même, où tout semblait stagner et où rien ne commençait vraiment. La guerre ouvre vers un ailleurs, qui a aussi ses ordres et ses déterminations, qui intensifie la sensation d’exister au milieu de la nuit. Ces combattants partagent sans doute l’idée selon laquelle il vaut mieux vivre dans un effort pour faire advenir des possibles incertains que sous les faux refuges de la vie ordinaire dont l’unique fonction est d’apporter de la réassurance momentanée, un maintien de la vie au lieu de son accomplissement.
Du tumulte infernal de la guerre, les hommes sortent métamorphosés dans leur vision du monde, leur sens et leur sensibilité. Elle les fait devenir autres. Les combattants arborent de nouveaux vêtements. Ils changent d’apparence. Ils apparaissent plus vieillis, les yeux cernés et fatigués. Leurs démarches évoluent aussi grâce à leurs nouvelles responsabilités. La personnalité s’affirme. Le cœur bat plus chaud dans la poitrine tant la vie est plongée dans un risque permanent. On réfléchit peu en ces temps. Le récent reportage photo réalisé par Quentin Sommerville et Riam Dalati illustre précisément les évolutions d’un djihadiste et la représentation de lui-même qu’il a choisi d’en faire.
Un être nouveau
En résumé, ce que la guerre provoque avant tout, c’est ce sentiment de s’être réveillé. Comme si, dans le passé, le combattant n’avait que végété bêtement dans l’espace le plus restreint de la vie. L’être devient « acteur de l’histoire » ; il est alors au contact de la grandeur et découvre la force bouleversante de l’engagement pour une cause. En ce sens, elle fait advenir un nouveau « Je ».
Le combattant devient un être nouveau qui se tient debout maintenant, à cet instant décisif de la guerre et de ses transformations quotidiennes. Il saisit toute la nouveauté de son existence ; de ses finalités, de ses formes de vie, de ses rapports de sociabilités, de ses paysages, etc. La guerre se présente sous la forme d’une aventure nécessaire bien qu’incertaine. C’est retrouver d’une façon ou d’une autre une vie à soi. Dorénavant, il n’est pas astreint à des activités qu’il n’a pas choisies, qu’il n’aime pas, et dont il ne se sent pas concerné. Il n’a plus à s’accommoder à une vie qui lui est pourtant étrangère. Ce sentiment d’être au plus près de son essence est une compensation qui rompt l’étau de la crainte qui étreignait autrefois les désirs.
Il fait désormais partie d’un groupe puissamment uni qui le soustrait à toute solitude. La haine et l’amertume, accumulées depuis tant d’années, remontent à la surface de l’individu et sont des affects partagés. L’adversaire autrefois insaisissable est désormais reconnu. On peut saisir ce dernier à la gorge. La vie s’illumine par ce courroux contre le monde insensé. L’engagement dans la guerre est une forme de contestation de la vie non-voulue.
La guerre est « joie » et organisation du vertige
Mais la guerre n’est pas simplement une réparation existentielle du passé. Elle est aussi l’occasion d’une joie. Elle est la joie de l’altération de l’ennemi, la joie de la résistance dans un contexte de profondes asymétries militaires. La consistance de la lutte armée réside dans le fait que les destructions renferment une charge de réalité. Le cours habituel des choses est interrompu. L’effet de la guerre s’offre au regard et rend visible la fragilité « malgré tout » de l’ennemi et de ses édifices. La guerre produit une expérience d’un genre particulier : elle dispose à l’existence, c’est à dire qu’elle ouvre à un individu la possibilité d’expérimenter une vie radicalement autre.
D’abord, d’un point de vue purement sensible, la guerre suppose une certaine excitation car la vie est toujours mise en jeu. Dans l’affrontement, le combattant atteint le noyau dur du réel. C’est une façon de reprendre prise avec le réel, ou plutôt, de retrouver le réel du monde. Les lamentations des pays ennemis émus par leurs morts suite aux attaques terroristes ajoutent encore davantage à cette joie d’inverser les registres de la puissance. Chez l’ennemi, on pleure aussi des vies.
La guerre offre donc une intensité rare : la joie du chaos et de l’ébranlement du monde. C’est la joie d’une réalité physiquement mise en péril. La finalité de cette action est inscrite en elle-même bien plus qu’en l’hypothétique croyance en la victoire du Califat et à sa domination sur quelques terres.
Fulgurances existentielles
La finalité est moins politique que morale. Elle relève donc d’une « morale de l’intensité ». Dans cette lutte pour la vie, le combattant éprouve sans doute cette sensation de vivre vraiment. Il ressent ceci physiquement avec l’intensification de ses sens : adrénaline, fatigue, usure, blessures, corps qui est traversé par la lutte. Il l’éprouve aussi spirituellement dans la mesure où la possibilité de la mort est une question essentielle qui est reconduite chaque jour dans sa conscience. La guerre est l’occasion de se sentir vivant et de déroutiniser le quotidien.
À l’ère de l’intensité comme le suggère Thierry Garcia (2016), il n’est pas étonnant que le djihad attire dans la mesure où il permet d’éprouver une vie « hors du commun » en engageant l’être tout entier vers un but précis. En quelque sorte, le djihad propose aux combattants des fulgurances existentielles dont il était autrefois privé. Le combattant est dans l’expérience de lui-même car il existe comme écart par rapport à sa vie d’autrefois. Il a tout abandonné et transformé : ses projets, ses visions du monde, son environnement existentiel, son corps biologique, les exigences immédiates de sa vie ordinaire. Son engagement est un appel au large, bien qu’il s’encastre dans l’étroitesse morale et intellectuelle du monde djihadiste. Cet enthousiasme pour la guerre construit la fiction personnelle et collective du désordre, du chaos et du recommencement.
Vertige de la destruction
La guerre construit aussi le vertige à travers la tentative de détruire un instant la stabilité de l’ordre social qui avait habitué chacun à l’impuissance. Elle est vertige car les temps d’intenses combats apportent à chacun cette espèce de panique voluptueuse. C’est l’étourdissement de l’anéantissement de la réalité, l’ébranlement des sens et de la vue où les édifices matériels tombent en ruine et troublent la vision.
Au cours du combat, l’homme se dépouille de toute sa peur, de toute son épouvante, comme un lourd manteau noir. Cette expérience existentielle mêle peur et jouissance.
D’une certaine manière, la guerre est une organisation du vertige. Elle organise une relation active avec le monde qui symbolise et tente la destruction pour rendre possible le recommencement. La guerre n’est pas seulement une effraction ; elle est la jubilation d’une prise sur le réel. Au fond d’ailleurs, le temps de la guerre se réfléchit peu ; il est oubli de soi, absorption de soi dans l’action et alliance avec les autres. Il est griserie, dérèglement des sens et organisation du vertige.
Retrouvez cet article sur le site The Conversation.